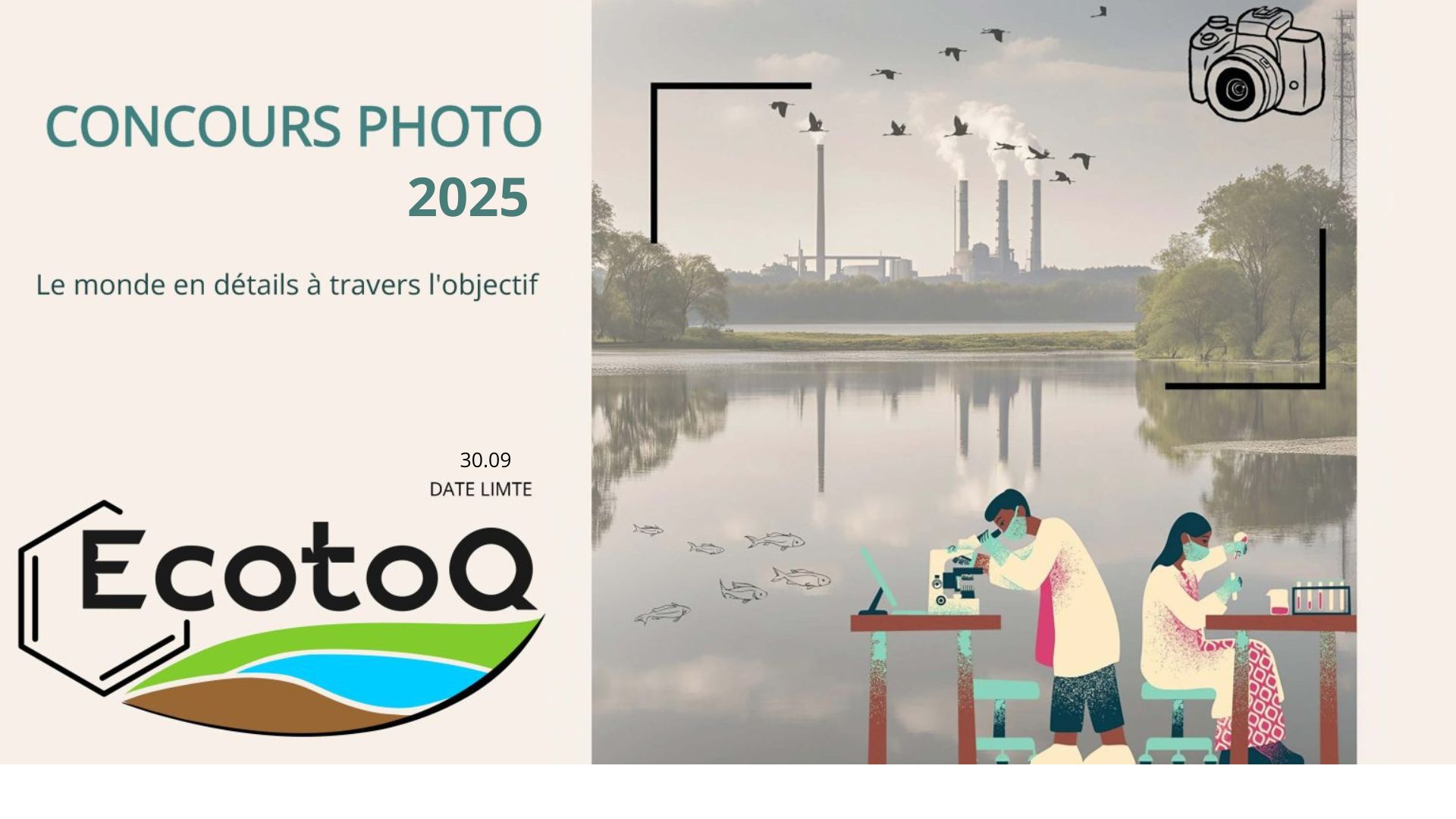
Publié le 20 novembre 2025
**English follows**
Catégorie Laboratoire
1ère place (150$)
Eve Perron-Labonté
(UQAM)
2e place (100 $)
Flavie Desreac
(INRS)

Professeur Quack-stein : spécialiste des plantes aquatiques
Natif des écosystèmes aquatiques, Professeur Quack-stein étudie les espèces végétales du Québec. Il en a récolté plusieurs dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, et il fait maintenant croitre ces plantes dans les serres à l’UQAM. Le but de la recherche de Professeur Quack-stein est de déterminer quelles espèces sont capables de retirer divers éléments traces métalliques de l’eau ! Professeur Quack-stein s’assure que les plantes sont dans des conditions optimales et que l’eau est changée régulièrement, mais son travail le plus important est le contrôle les insectes ravageurs qui se sont introduits dans la serre! Sur la photo, à gauche de Professeur Quack-stein, on observe du scirpe, de la prêle et de la pontédérie, alors qu’à droite, on voit de la sagittaire, des joncs et du roseau commun. Grâce à son travail acharné, nous connaissons mieux les capacités des plantes à retirer des contaminants métalliques dans des plans d’eau québécois. Merci Professeur Quack-stein !
Sous les rayons du radium : quand les microalgues dévoilent une histoire cachée.
Je me tiens devant une série d’erlenmeyer contenant des cultures de microalgues vertes. Chacun porte le poids d’une expérience complexe : l’étude des effets du radium-226. Cet élément radioactif est naturellement présent dans les sols et eaux. Peu étudié, on se pose la question cruciale de son impact sur les organismes d’eau douce. Mon projet vise à comprendre ses effets aux travers de la toxicité, la bioaccumulation mais aussi les mécanismes intracellulaires de défense ou de stress que ces micro-organismes mettent en place face au radium. Les microalgues, producteur primaire et base des réseaux trophiques aquatiques, sont des sentinelles idéales pour dévoiler l’impact du radium dans l’écosystème. Cette photo présente un moment d’observation presque de méditation devant les microalgues dont je m’occupe depuis presque 3 ans. Derrière la lumière artificielle des chambres de cultures, chaque erlenmeyer devient un témoin du l’impact dangereux du radium mais surtout une source de savoir. En effet, comprendre comment le radium s’accumule et impacte les cellules, c’est ouvrir la voie vers la mise en place de norme pour gérer et protéger l’environnement. Ainsi, cette image n’illustre pas seulement mes expériences de laboratoire : elle donne une voix aux microalgues pour mieux anticiper l’impact jusqu’ici invisible du radium-226.
Catégorie Organisme
1ère place (150$)
Mathilde Baranton
(UQAM)
2e place (100 $)
Sofia Higgs
(UQAM)
Les premiers pas au sein de la colonie, cocon ou poison ?
Porpoise Problems
Cette photo me rappelle mon premier stage sur le terrain. J’ai eu la chance de collecter des données sur le marsouin commun et d’autres espèces de mammifères marins dans le Saint-Laurent. Le marsouin est une espèce qui est élusif et peu étudié dans le Saint-Laurent. Les problèmes de marsouins, surtout le nombre d’échouages qui a augmenté dans les dernières années m’ont donné un sérieux coup de poing. Ce stage m’a non seulement donné la passion pour la recherche et la conservation des mammifères marins, mais il m’a aussi incité à poursuivre mes études de maîtrise sur le marsouin commun et le béluga du Saint-Laurent. J’ai compris l’urgence de la recherche, et c’est là que j’ai su que ma voie était tracée.
Catégorie Terrain
1ère place (150$)
Karima Hadria Gondry
(INRS)
2e place (100 $)
Mouna Hamrouni
(UQAR)

À la pêche sous la glace
Cette photo a été prise en mai, lors d’une sortie sur le terrain proche de Cambridge Bay au Nunavut, durant laquelle nous avons échantillonné du zooplancton. Le filet, que l’on voit ici en train de remonter, a plongé jusqu’à une vingtaine de mètres sous la glace, elle-même faisant 1,70 d’épaisseur à ce moment. La couleur bleutée de la glace sous la tente était extraordinaire. Nous avons récolté beaucoup de copépodes lors de cette pêche, que nous avons rapportés au laboratoire pour y effectuer des tests de toxicité.
Marée d’échantillonnage : la nature entre ciel et algues
Après une journée venteuse à la Pointe-au-Père, nous avons pris le temps de récolter les algues avec précaution, coupant chaque thalle à environ 15 cm de sa base pour laisser le crampon solidement accroché au substrat. Cette méthode nous permet de prélever des échantillons représentatifs tout en respectant la vie qui s’y attache. L’échantillonnage s’est déroulé dans une zone d’environ 15 m de diamètre, ce qui nous a permis d’observer et de récolter une belle diversité de formes et de textures, révélant toute la richesse de cet écosystème.
Ces algues seront utilisées dans le cadre de mon projet de recherche pour extraire les alginates et développer des composites biosorbants écologiques, capables de piéger les métaux lourds, les terres rares et d’autres polluants. C’est une manière simple et naturelle de contribuer à la protection de l’environnement. La photo illustre ce moment sur le terrain, un instant où science, innovation et respect de la nature se rencontrent, mettant en valeur le rôle des algues comme véritables sentinelles du Saint-Laurent, entre ciel et eau.




